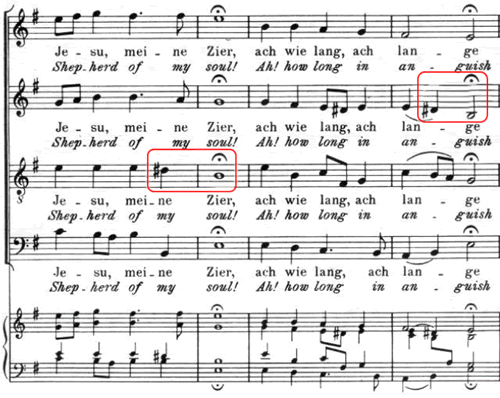Mouvement de la sensible

"Il me semble que la sensible monte toujours vers la tonique. Or j’ai constaté que dans les parties intérieures des exercices que j’ai réalisés ce n’est pas toujours le cas. Ceci est d’autant plus visible que dans les tonalités mineures, les sensibles sont altérées"... Lire la réponse
Il n’y a en fait aucune obligation à ce que la sensible se dirige vers la tonique. Vous pourrez l’observer à loisir dans la littérature musicale comme le montre l’exemple extrait d’un motet de Bach. Heureusement d’ailleurs, car lorsqu’il faut écrire plusieurs voix, cela serait une contrainte trop restrictive.
Toutefois, la relation privilégiée entre la sensible et la tonique est une composante mélodique essentielle du mode équivalente à celle qui existe entre la dominante et la tonique. Ce sont des mouvements "naturels" au sein du mode qui permettent de l’identifier : la sensible se tend vers la tonique et la dominante tombe (cadere = tomber en latin, d’où le terme cadence) sur cette même tonique. On retrouve d’ailleurs ces deux mouvements mélodiques dans la cadence parfaite. C’est ce qui explique d’ailleurs son caractère conclusif.
C’est la raison pour laquelle la sensible monte le plus souvent vers la tonique.
Cet exemple est tiré du motet de J.S. Bach "Jesu mein Freude" BWV 227. Le motet est une pièce écrite pour les voix. Celui-ci, en mi mineur comporte quatre parties : soprane, alto, ténor et basse (de l’aigu au grave). Sous les 4 voix séparées, il y a la partie de clavier reprenant ces 4 voix.
Dans cet exemple en mi mineur, on peut observer deux fois un mouvement sensible-dominante au lieu de sensible tonique :
Mesures 1-2 au ténor : la sensible ré# ne dirige pas vers la tonique mi mais sur la note si, la dominante.
Mesure 4 : même mouvement mélodique à l’alto cette fois.
On notera qu’il s’agit pourtant de cadences parfaites qui concluent à chaque fois une phrase du choral et que la sensible est située aux voix intermédiaires. Lorsqu’elle se trouve aux extrêmes, elle se résout de manière plus naturelle vers sa tonique.
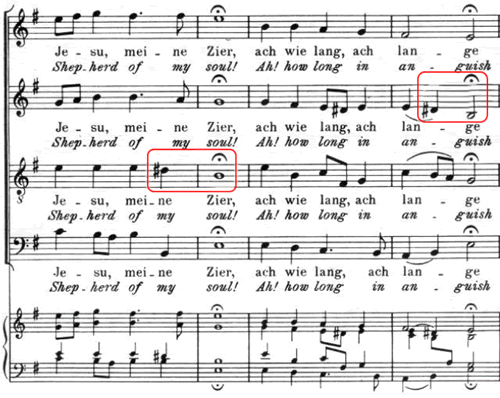
Pour J.S. Bach, l’intérêt de la ligne mélodique est primordial. Dans cet exemple, la succession sensible-dominante lui semblait donc plus judicieuse.
Aussi si Bach procède ainsi, vous pouvez bien sûr le faire également :)
article publié le mercredi 1er octobre 2008 et lu 7553 fois.
Jean-Luc KUCZYNSKI est compositeur et professeur de composition musicale depuis 1988 aux ACM et depuis 1999 à l’école d’écriture et de composition Polyphonies.
Vous avez aimé cet article ? Alors partagez-le avec vos amis !
Articles les plus lus de Jean-Luc KUCZYNSKI
Chiffrages et notation des accords (I). Les chiffrages américains
Toute musique basée sur la tonalité et les modes, qu’elle soit classique, jazz, chanson ou autre dispose des même sept accords. Leur structure est relativement simple et strictement identique dans toutes les musiques. Toutefois, leurs chiffrages ou leurs notations différent et peuvent sembler parfois d’un abord complexe. Dans cette petite mise point, nous nous intéresserons d’abord aux chiffrages américains, utilisés en jazz et en musique de variété puis au prochain article, au chiffrage classique de la basse continue.
Article
Dans Comme par exemple • le 20 mars 2013 • 223059 lectures
Petit lexique de l’étudiant en composition (mise à jour juin 2015)
Voici une sélection d’œuvres incontournables, classiques et contemporaines, que nous vous conseillons d’écouter et de lire en vous procurant les partitions (lorsque cela est possible, pour une majorité des œuvres présentées). Ce lexique traverse toute l’histoire de la musique occidentale (de Guillaume de Machaut à Pascal Dusapin).
Il est enrichi régulièrement de dossiers musicologiques vers lesquels pointent les hyperliens indiqués sur l’œuvre, le compositeur ou l’époque.
Nous conseillons de vous y plonger de temps en temps, et de la garder sous le coude tout au long de votre formation !
MISE A JOUR : juin 2015 Lire l’article
Article
Dans Dossiers musicologiques • le 23 mai 2015 • 28644 lectures
Lire une partition d’orchestre
Suivre la musique sur une partition d’orchestre est plus aisé qu’on ne pense avant de s’y être essayé. Toutefois, il importe de connaître certaines conventions de présentation qui régissent l’écriture d’une telle partition. Cet article présente les principales indications instrumentales à connaître et leur évolution, pour vous permettre, élèves de Polyphonies, de vous appuyer sur ce mémo, non seulement lorsque vous suivez la partition de l’œuvre que vous écoutez (activité que nous ne conseillerons jamais assez), mais aussi dans vos propres recherches en écriture ou vos travaux d’orchestration.
Article
Dans Comme par exemple • le 5 septembre 2007 • 95068 lectures
Chiffrages et notation des accords (II). Basse continue et basse chiffrée
Après avoir abordé les chiffrages américains, nous abordons un autre système de notation des accords également destiné aux instrumentistes : la basse continue qui est devenue la basse chiffrée. Il est intéressant de comprendre son principe car cette technique d’écriture a généré le chiffrage qui a cours dans les traités d’harmonie classique.
Article
Dans Comme par exemple • le 7 août 2013 • 86332 lectures
Introduction à l’analyse : l’art de la variation dans la sonate k331 de Mozart (IV)
De tous temps, la variation a été un genre musical très prisé des compositeurs. Elle offre en effet des possibilités de renouvellement mélodique ou harmonique quasi illimitées. Poursuivons donc l’étude du premier mouvement de la sonate pour piano k331 de Mozart, dont nous avons déjà abordé le thème dans un précédent article, par l’analyse de la première des six variations. Et découvrons également l’art de la variation de Mozart. lire l’article
Article
Dans Comme par exemple • le 15 octobre 2015 • 31948 lectures